C’est que ça commence un poil à m’agacer cet emploi du mot « travail » et, sans faire métier de Job, je trouve qu’on se besogne un peu trop le bouleau car seul l’opéra rend libre.
Quelle est la valeur du travail (pris ici au sens trivial et non étymologique) ?
Le moralisme marxien voudrait que ce fût une valeur horaire : l’œuvre vaudrait autant que le temps de l’ouvrier (en plus de la matière première).
C’est gentil comme une médaille en chocolat, « tout le monde a gagné, c’est la participation qui compte ». C’est gentil, l’égalitarisme, mais c’est une construction anti-naturelle et injuste : certains mettront des jours à assembler une bouse malhabile, d’autres des heures à produire un chef d’œuvre, et souvent le grossier besogneux a plus d’ancienneté dans la stagnation que le génie naturel dans la fulgurance (par exemple, mon niveau pitoyable en dessin par rapport à celui de certains adolescents de 14 ans). Devrait-on, en cumulant l’ancienneté et les heures passées, accorder plus de valeur à la médiocrité qu’à l’excellence rapide et géniale ? On fera comme on voudra : l’acheteur choisira le meilleur produit en s’asseyant allègrement sur cette comptabilité rétributive.
Le pragmatisme libéral voudrait que ce fût une valeur de demande et de rareté : la marchandise ne vaudrait que si elle est désirée, indépendamment de sa qualité et de son utilité.
C’est ce qu’exploitent les marques depuis des décennies avec la « valeur perçue » : les consommateurs achètent la marque en tant que symbole de statut, indépendamment de toute réalité qualitative ou éthique. Et c’est bien là toute la laideur du libéralisme économique : il est pragmatique. Ni idéologie ni morale, il s’agit d’une description objective des mécanismes humains, sociaux, du désir et de la confiance, pour surfer l’énergie psychique des flux boursier et en tirer le plus de puissance personnelle possible en magicien du Chaos résolument individualiste et amoral. Certains en tirent gloire, se félicitant de leur intelligence et de leur maturité qui laisserait l’idéalisme idéologique aux adolescents : il me semble qu’ici l’intelligence s’écarte dangereusement de la sagesse.
Sans égalitarisme ni pragmatisme, j’aurais la tendance peut-être théocratique de considérer que la valeur de toute chose comme de toute entreprise se mesure à l’aune du Salut collectif et trouve sa rétribution avant tout dans la satisfaction de l’accomplir, sans même songer à un retour sur investissement post mortem (la Jérusalem Céleste n’étant pas un portefeuille de bonnes actions avec intérêt). Par Salut collectif, j’entends la tension vers le Beau, le Bon et le Vrai. Une œuvre, un emploi, un effort a autant de valeur qu’il permet à un groupe donné de s’élever en lui procurant de belles et bonnes choses et en l’instruisant.
C’est bel et bon, ô Sokratès, mais ça ne fait pas avancer notre affaire d’un pouce puisqu’on ne vit pas de satisfaction personnelle et que l’instance qui s’arrogerait le droit de statuer de ce qui est beau, bon et vrai et fixer ainsi la valeur du «travail » serait une chose atrocement dangereuse et immanquablement laide, mauvaise et fausse. En plus, ça n’est même pas le sujet qu’il m’importe de traiter

Non ce qui m’importe c’est l’inflation du terme « travail » en tant que valeur, que processus créateur par lequel on trouve sa place dans la société, par lequel on devient quelqu’un, par lequel on façonne le monde. Ce processus n’est PAS du « travail », c’est une œuvre, c’est un emploi, c’est un effort, toutes choses belles et nobles, pas du « travail », douloureuse saloperie d’esclave.
Mon agacement envers le mot « travail » vient de deux milieux en particulier : l’ésotérisme et la photographie amatrice (et se prenant pourtant terriblement au sérieux), auxquels on peut ajouter le journalisme qui s’en gargarise pour ajouter du sérieux, de la pesanteur, de la gravité, de la matière (c’est à dire de la merde) à tout ce qui au contraire devrait rester jeu, légèreté, intimité, vapeur sacrée.
Tels souillons de basse-cour auto-proclamés prêtresses de Monküh Surlak-Ömod ou autres sorcières aussi efficaces qu’une directive européenne parlent à tort et à travers de leur « travail avec les divinités / esprits / guides / ancêtres » ou du « travail de l’ombre », choses qui n’ont absolument rien à voir avec quelque notion de travail que ce soit, sauf celui de l’accouchement peut-être qui aurait sens dans le cadre de l’intégration jungienne de l’ombre. Personne ne « travaille » avec une divinité ou entité : on l’adore, on l’honore, on la glorifie, on peut tenter de canaliser ou manifester son énergie, et surtout on œuvre avec elle, au sens alchimique et artistique. C’est à dire que l’on crée dans le monde matériel à partir d’énergies spirituelles (ou vice versa lorsqu’on sacrifie). Mais on n’a pas d’horaires de bureau, de salaire, d’impôts, de n+1, 2 ou 3, on ne fertilise pas la terre de sa sueur, on ne ploie pas sous le joug, on n’obéit pas à la volonté d’un autre, on ne se fait pas torturer : ça n’est donc pas du travail.
Tels photographes et modèles disent les même sottises (mais en employant « bosser » et « tafer », parce qu’il faut faire croire qu’on est cool et détaché tout en revendiquant le sérieux) alors qu’ils ne sont pas en agence, ni en free lance, ni employés et qu’il n’y a aucune transaction d’argent (parfois un pseudo-contrat pour se donner l’illusion du professionnalisme). En réalité c’est une graphiste et un étudiant, ou un ingénieur et une secrétaire, qui s’amusent à faire de l’art sur leur temps libre : personne ne gagne sa vie, personne ne risque quoi que ce soit si c’est un échec, tout le monde a une autre source de revenue (ou rien du tout), tout le monde s’amuse et crée, et il me semble que c’est faire insulte à ce plaisir artistique que le traiter de « travail ». Parfois cependant le ou la photographe est réellement professionnelle, mais soyons sérieux (ou au contraire ne le soyons surtout pas), il ne s’agit toujours pas de « travail » pour autant. Il s’agit d’un métier, d’un emploi, et surtout d’un art, pas d’un « travail ».
Tels journalopes souillent absolument tout ce qu’ils peuvent du nom de « travail » avec l’idée que seule cette estampille serait sérieuse et réelle : qui dit travail dit argent, et dans leur monde, seul l’argent, l’échange chiffré, rend les choses importantes. Même et surtout quand il s’agit de dénoncer el famoso « système » (capitaliste, libéral, occidental, blanc, enfin « le systaymanh, quoi »). Ils parlent de « travail de deuil » (là encore, pourquoi pas s’il s’agit d’une parallèle avec l’accouchement dans la douleur) de « travail de déconstruction » de « travail sur le silence » de « travail de la matière visuelle » de « travail d’élargissement anal des mouches non consentantes ».
Un travail, c’est quand c’est dur, salarié, encadré, aliénant, servile et une torture. C’est étymologique (le tripalium, instrument de torture des esclaves rebelles), philosophique, biblique (où c’est une malédiction divine). Quand on se lève à regret pour accomplir une tâche désespérante et mal payée où on exécute des ordres dans des conditions déplorables, là oui, c’est du travail. Et ça ne rend libre que quand on en sort, soit que l’on ait enfin pu changer d’activité, soit que quelque chose ait changé et que soudain l’effort ait trouvé du sens, une utilité et une noblesse qui en fasse un moyen d’émancipation et de transformation du monde. Alors ça n’est plus un travail, mais qu’est-ce donc ?

Comment nommer cette activité quotidienne ou presque qui nécessite des efforts pas toujours agréables mais nous donne une place, une fonction, une justification en nous rendant artisan du monde et bienfaiteur de la communauté (que ce soit en la nourrissant, en l’embellissant, en l’organisant, en l’enseignant, en la soignant etc.) ?
Le meilleur nom me semble celui d’œuvre : on crée ou on produit une œuvre, on œuvre à quelque chose. Opus en latin (opera au pluriel), de ops, la force (opératoire), que l’on retrouve dans üben en allemand. Work ou Werk dans les langues germaniques, où l’œuvre est caractérisée par son effet, Wirkung, dans une fertilité exponentielle qui fait de l’ouvrier une sorte de démiurge (son œuvre engendrant elle-même des effets etc.).
Pour détourner deux philosophes germaniques, l’Arbeit ne rend pas libre. Le détestable Arbeit est l’équivalent de notre « travail » : une activité d’esclave ; mais il peut être un moment, une étape vers l’œuvre : Werk macht frei !
L’emploi aussi est beau dans sa désignation de ce qui nous attache au corps social, qui nous « implique » (sa racine étymologique) dans le groupe : mon emploi, que ce soit celui d’un montreur d’ours, d’un garde, d’un chanteur de rue ou d’un postier, fait de moi un membre de la société.
Le métier conviendra parfaitement à ceux qui ont une vocation forte et pour lesquels l’emploi prend une valeur de sacerdoce et de service du bien commun, puisqu’il a la même racine que « ministère », c’est à dire service.
Enfin, la notion d’effort rend bien compte de ce que le labeur a de désagréable et de lutte sans pour autant en faire une chose servile : la contrainte ici est comprise et auto-infligée. On se fait violence pour un but que l’on sait bon, et on y met tout son cœur, son courage (c’est l’origine de fortis, donc d’effort : l’acte des forts, des braves, de ceux qui ont du cœur).

Deux choses, qui n’en sont peut-être qu’une (ou dont l’une est peut-être une facilité un peu fausse) me semblent responsable de cette laborieuse inflation.
Tout d’abord la fameuse « éthique protestante du travail », devenue morale publique avec l’avènement révolutionnaire de la bourgeoisie au XIXeme siècle : le devoir d’action sur le monde, l’enrichissement comme bénédiction, de paire avec l’austérité esthétique et les signalements de vertu. On connaît le topo : les hommes d’affaire affairés, vêtus de sombre comme des drapiers de Hollande, la façade vertueuse étriquée avec l’invention de la femme domestique (« l’ange du foyer »), toutes ces choses dont ironiquement certains mouvements catholiques auto-proclamés « tradis » et anti-bourgeois réclament le retour (on les voit bien moins réclamer le retour de la joyeuse volière des couleurs de l’aristocratie catholique, ses bas de soie, ses dentelles, ses roses et ses azurs). Seulement voilà, ce topo tourne à la vieille rengaine et au prêt à penser dont on n’interroge plus la pertinence. Il tourne presque à la blague de bar « C’est un Hollandais, un Français et un Italien qui entrent dans une église baroque… ». ça n’est pas parce que Weber a théorisé un modèle intéressant qu’il est parole évangélique et tout ce qui est sobre et sérieux n’est peut-être pas systématiquement à reprocher aux bourgeois protestants.
C’est également une tendance que je crois voir naître, ou plutôt ressurgir car ces tendances sont cycliques, dans les années 1980 et s’accentuer fortement depuis six ou cinq ans.
Même si les années 1980 constituent un âge d’or cinématographique et musical, peut-être faut-il y voir plutôt les feux du couchant comme le montre l’excellent Velvet Goldmine, film qui suit les transformations esthétiques du milieu musical anglo-saxon à travers une figure bowiesque : l’avatar des années 1980 du personnage central est lisse, télévisuel, américanisé, capitalisé. La foule qui l’entoure est terne : blousons, café, cigarettes et ralentissement économique.
Maquillages fluo, certes, chant du cygne glam metal, néons, bouquet final, mais il me semble que la joyeuse expérimentation dans les formes et les structures décroisse. On dé-prismatise, on focalise, on lisse, on rend lisible, efficace (et voici que les protestants reviennent par augustinisme, fichtre!). Il va falloir des résultats, que ce soit dans l’économie ou la création graphique. Même les formes les plus outrancières du théâtre expérimental (Schaubühne, Living Theater) se rigidifient au cours des années 1980 pour devenir de nouvelles normes du snobisme (une de mes professoresses disait «dans une mise en scène contemporaine il FAUT un mec à poil et un nazi », et en 2023 absolument rien n’a changé. L’expérimentation vieille de cinquante ans étant devenu le nouvel académisme convenu, qui aurait l’audace révolutionnaire de ne pas mettre l’obscénité sur scène ?).
Le sérieux progresse, envahit tout.
Au milieu des années 2010 le sérieux s’en prend à l’humour, qu’il soit sur scène ou dans des groupes de discussion. Il ne faut pas rire.
Il ne faut pas non plus faire de goûters en classe car les élèves peuvent être allergiques et les familles procédurières.Il ne faut pas diffuser de trombinoscopes, il faut tout considérer « avec le plus grand sérieux » (le possible harcèlement, les possibles répercussions de tout, les possibles réactions si une sensibilité est heurtée, les possibles procédures légales). On est sérieux partout, tout le temps, et on ne rit plus que sagement, dans des bornes strictes, ou comme arme cinglante.
On doit travailler, consommer, ricaner. Rien n’a de valeur que le travail : ainsi le hobby, le loisir, l’art, la création, la recherche, le baguenaudage parfois fécond doivent-ils se déclarer comme « travail » pour être « pris au sérieux ». C’est très important d’être pris au sérieux, de ne surtout pas être un « bouffon », une « blague » sur pattes.
Il faut rire gentiment à des références pop-culturelles (« eh, t’as la ref? t’as vu la ref? »). Il faut ricaner de son ennemi, mais ricaner sérieusement, avec tout un « travail humoristique sur le rire de résistance » (et la possibilité d’aller en parler sur France Culture). Les sales petits « ricaneurs résistants » de droite ricanent des féministes (« Toutes des célibataires dépressives qui bossent pour un patron alors que ça pourrait être leur mari et leurs gosses, leurs patrons, ces connes ! Et puis, hein, jusqu’à ce qu’il faille porter des trucs lourds honhonhon. D’ailleurs elles préfèrent se faire baiser par des hommes, des vrais. Moi, les 4 dernières que j’ai consommées…, non je ne parle pas de ma femme hinhinhin,… »), leurs équivalents de gauche font de même à propos des catholiques et des français moyens «Ah bah le french dream ma gueule, bien mayonnaise, bien Française des jeux, bien pavillon de banlieue, bien gros beauf qui vote RN, bien consanguin… Et puis les curés pédophiles hahaha, et puis tema la famille de Jésus : deux pères et une mère porteuse ! Hein ! Et quelles sont les deux fêtes des zombies ? Halloween et Pâques rhinrhinrhgrouik ».
Il faut rire à thèses, rire polémique, rire dissident.
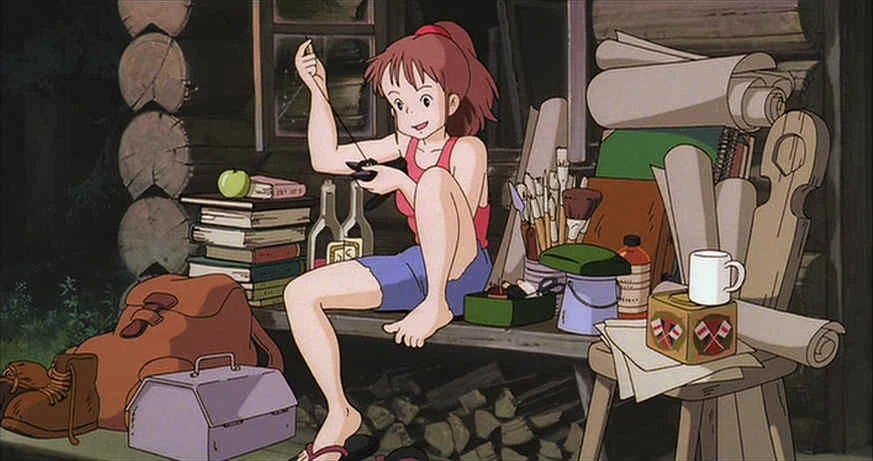
On l’aura compris, ce sérieux me pèse. Je ne dis pas qu’il faille être médiocre, approximatif et superficiel, bien au contraire, mais accompagner notre quête du Beau et du Vrai d’une saine dose de légèreté.
Être pesant n’est pas plus une garantie de qualité que le port de la veste autrichienne n’est une garantie de rectitude. Être compassé ne garantit pas davantage de bien avoir l’aiguille au Nord.
Je ne dis pas non plus qu’il faille tout prendre à la légère dans une ironie XVIIIemiste toute pastel et jankélevienne : il est bon d’adhérer à ses principes, à ses enthousiasmes, à soi-même, d’être plus contrasté que nuancé (du moins ça me plaît, à moi, qui suis plus amatrice de Don Lope de Villalobos y Sangrin que d’Armand Raynal de Maupertuis (« eh, tas la ref ? »)). On honore le drapeau, ses morts et son Dieu avec gravité, et on peu se marrer après coup comme les soldats, les morts et Dieu lui-même le firent (un de mes versets favoris de la Bible : Ps. 104 – 26. Dieu créant la monstruosité pour le rire… Pour rire ? Pour jouer ? Pour jouer avec elle ? Pour rire d’elle ? Pour qu’elle se joue et se rie des hommes ? Pour le fun ? Beauté féconde des interprétations… Mais comme on dit dans les fandoms : c’est canon, Dieu crée AUSSI pour le jeu et le rire.)
Il me semble que le rire, comme l’art, doivent toujours être gratuits : leur donner une fonction (polémique et dénonciatrice) c’est les empeser, rogner leurs ailes, les empêcher de s’élever et de nous emporter sur leur dos dans l’ivresse des hauteurs.
Il nous faut créer, œuvrer, nous efforcer, cultiver la joie et rire de bon cœur, sans jamais souiller tout cela par le sérieux et le travail.
Il faudrait même nous employer à abolir le travail.

« Personne ne « travaille » avec une divinité ou entité : […] on n’obéit pas à la volonté d’un autre, on ne se fait pas torturer » : hmmmm, ça dépend ?
J’aimeJ’aime